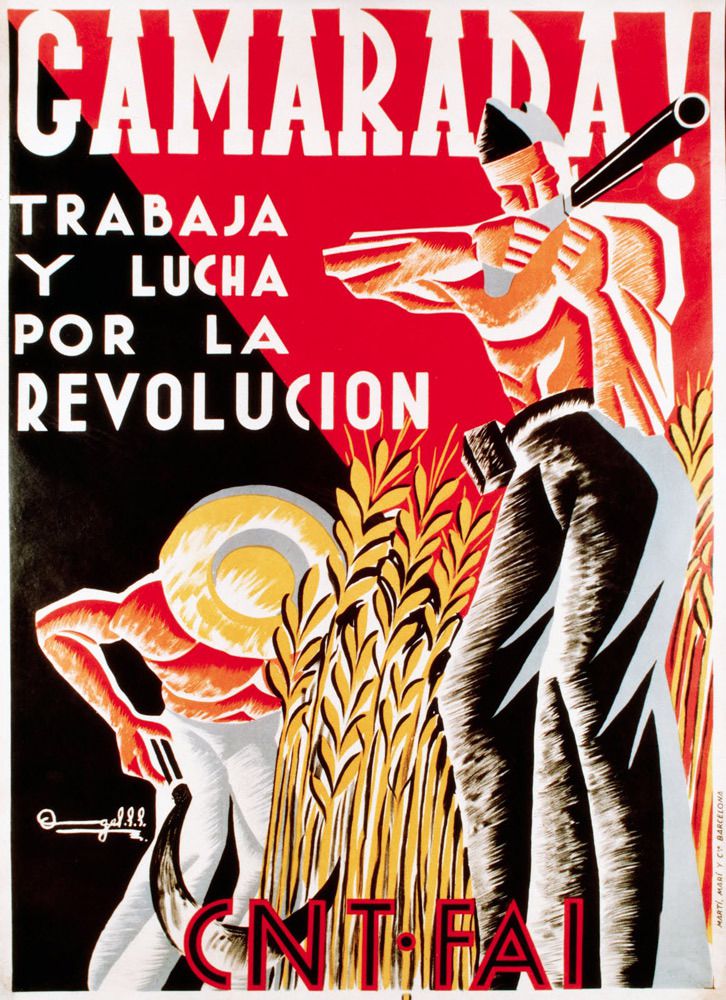Article CNT-AIT 2006
UNE COURTE APOGÉE (1945 – ANNÉES 1950)
jeudi 19 octobre 2006
Nous verrons dans cette première partie comment la C.N.T., après sa constitution, connaît une rapide apogée. Elle fut écourtée par des problèmes théoriques et pratiques qui divisèrent la C.N.T. Ces divisions affaiblirent fortement l’organisation et la plongèrent dans un isolement dont elle n’est pas parvenu à sortir.
1- Des débuts prometteurs (1945-1949)
a) Les anarcho-syndicalistes dans la C.G.T. (1945-mai 1946)
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, les anarcho-syndicalistes étaient entrés à la C.G.T. Les anciens adhérents à la C.G.T.-S.R., qui avait cessé d’exister pendant le conflit [1], dans un appel daté du 15 septembre 1944 adressé aux syndicalistes révolutionnaires, demandèrent en effet “de faire, tous, l’Unité Syndicale, complète, totale, absolue, qui nous donnera dans ce pays une seule Centrale Syndicale : la C.G.T. ; dans le monde une seule Internationale dont peu importe son titre.” [2]. Ainsi, plutôt que de faire renaître une C.G.T.S.R., ses anciens adhérents ont préféré former la Fédération Syndicaliste Française (F.S.F.) afin de regrouper tous les syndicalistes révolutionnaires au sein de la C.G.T. Ils créèrent en même temps un journal, L’Action syndicaliste. Outre les anciens de la C.G.T.S.R., la F.S.F. était composée de jeunes issus de la résistance, tel que Raymond Beaulaton, ou bien encore d’espagnols en exil en France. L’importance de cette F.S.F. en terme d’adhérents est difficile à évaluer. Selon Aimé Capelle [3], on pouvait compter environ 2000 adhérents rien que sur Paris. Toujours selon Capelle, la F.S.F. aurait surtout été constituée par “les copains des métaux”, et dans une moindre mesure par “les copains du bâtiment” qui avaient reconstitué le S.U.B. (Syndicat Unifié du Bâtiment, principal syndicat de la C.G.T.S.R.). Des sections F.S.F. se sont constituées à Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Nazaire. Une toute autre estimation de la F.S.F. est donnée par l’union locale de la C.N.T. de Bordeaux en novembre 1947 : “La F.S.F. n’eut pas grand succès. Elle ne groupa jamais plus de quelques centaines d’adhérents, -presque tous anciens de la C.G.T.S.R.- et surtout elle n’eut aucune influence dans la C.G.T.”. On peut ainsi affirmer que la F.S.F. n’eut aucun poids au sein de la C.G.T., bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément ses effectifs. Si la F.S.F. semble être une tendance de la C.G.T., ses statuts sont assez flous et même proches de ceux d’une centrale : “Article premier. -La Fédération Syndicaliste est organisée sur la base de groupes locaux intersyndicaux, ou, à défaut, de groupes régionaux. Dès que le nombre de leurs membres le permet, les groupes doivent constituer des sections industrielles qui, elles-même, devront s’appuyer sur des sections d’ateliers, chantiers ou bureaux.” [4]. D’après cet article, il est donc possible de constituer dans une entreprise une section F.S.F. à côté d’une section C.G.T. L’article 2 montre également que la F.S.F. se présente comme une organisation à part entière plus que comme une tendance de la C.G.T. : “Article 2. -Les adhérents des groupes peuvent être membres d’une Centrale Syndicale non adhérente à l’A.I.T.[…]”. Or, la F.S.F. est la seule section française de l’A.I.T. (selon les statuts de l’A.I.T., il ne peut y avoir qu’une seule section par pays). Elle se présente comme une organisation syndicale tout en autorisant ses membres à adhérer à une autre centrale. Elle ne s’affirme donc pas comme une tendance organisée de la C.G.T., bien qu’elle n’existe qu’au sein de cette dernière. L’objectif de la F.S.F. au sein de la C.G.T. n’était autre que de s’opposer à sa direction, et de diffuser les idées syndicalistes révolutionnaires. L’article fondamental des statuts de la F.S.F. présente un condensé du syndicalisme révolutionnaire. Apparaissent les thèmes de “suppression du patronat, d’abolition du salariat et la disparition de l’État”. Elle vise l’instauration d’une société basée sur le “communisme libre”. Il paraît d’ailleurs plus judicieux de parler d’anarcho-syndicalisme plutôt que de syndicalisme révolutionnaire. A la lecture des statuts, il est peu probable que la F.S.F. ait pu recruter les syndicalistes révolutionnaires regroupés autour de la revue Révolution prolétarienne. La F.S.F. affirme clairement son opposition aux partis politiques : “Son action se déroule en dehors de celle de tous partis politiques et en opposition avec ceux-ci” (article fondamental). Il est également ajouté qu’“en aucune façon, ils (les adhérents de la F.S.F.) ne peuvent être membres de partis politiques” (article 2).
Ces deux extraits montrent la nécessité de distinguer syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme (même si les anarcho-syndicalistes se désignent comme syndicalistes révolutionnaires). Pour les anarcho-syndicalistes, le syndicat se situe au-dessus du parti politique et s’oppose à ce dernier. En revanche, les syndicalistes révolutionnaires tels que Pierre Monatte estiment que le syndicat doit être indépendant du parti politique mais attribuent au parti un rôle révolutionnaire (cette distinction renvoie à l’opposition qui était apparue lors du congrès de la C.G.T.U. à Saint-Etienne en 1922, avec d’un côté la tendance anarcho-syndicaliste de Pierre Besnard et de l’autre la tendance syndicaliste révolutionnaire de Merrheim).
Pour diffuser ses idées anarcho-syndicalistes, la F.S.F. crée un périodique, l’Action syndicaliste (n°1, mars 1945). Dès le numéro 2 de l’Action syndicaliste (avril 1945) apparaît le thème de la “grève générale insurrectionnelle et expropriatrice”. En lisant l’organe de la F.S.F., on comprend très clairement que les anarcho-syndicalistes ont pour priorité de lutter contre les dirigeants de la C.G.T. accusés d’avoir trahi les principes du syndicalisme révolutionnaire, la lutte des classes et l’action directe. La F.S.F. s’opposa entre autres à la bataille de production encouragée par les dirigeants communistes de la C.G.T. Derrière cette opposition à la bataille de la production, apparaît l’opposition au thème d’intérêt général, contre lequel se battait déjà la C.G.T.-S.R. pendant l’entre deux guerres (pour les anarcho-syndicalistes, reconnaître l’existence d’un intérêt général revient à nier la lutte des classes). La F.S.F. s’insurgea à plusieurs reprises contre la modération revendicative de la direction cégétiste (présence des ministres communistes au gouvernement oblige). Elle soutint notamment la grève des rotativistes en janvier 1946 qui manifestaient un rejet de l’orientation confédérale. La F.S.F. protesta également face à la prise de position des dirigeants confédéraux lors des élections de 1945 : le soutien aux candidats de gauche était en effet considéré comme une trahison du principe de l’indépendance du syndicalisme à l’égard des partis politiques. Selon Roland Biard, les militants de la F.S.F. de Paris auraient rédigé un communiqué daté du 8 octobre 1945 appelant tous les syndicats et tous les syndiqués à s’insurger contre une telle attitude [5].
Parallèlement à cette F.S.F., les anarcho-syndicalistes ont contribué à la création des Comités de Défense Syndicalistes (C.D.S.). La F.S.F. ne pouvant recruter que des anarcho-syndicalistes compte-tenu de la rigidité de ses statuts, ceux-ci constituèrent ces C.D.S. avec l’aide d’autres tendances minoritaires de la C.G.T., notamment des trotskistes du P.C.I. (Parti Communiste Internationaliste, section française de la IVième internationale). Les C.D.S. étaient ouverts à tous ceux qui étaient opposés à la main-mise des communistes sur la C.G.T. Le secrétaire était Aimé Capelle (également à la F.S.F.). Selon son témoignage, des C.D.S. se seraient constitués à Toulouse, Marseille, Bordeaux, Angers et Lyon. Les C.D.S. publiaient un journal, la Bataille syndicaliste, faisant ainsi allusion à la C.G.T. d’avant 1914. Aimé Capelle avait également été nommé administrateur de la Bataille syndicaliste. Le contenu de ce journal était relativement proche de celui de l’Action syndicaliste, dans un souci de dénonciation de la direction cégétiste, et de défense du principe de l’indépendance du syndicalisme. Bien qu’ouvert à tous, ces C.D.S. semblent constitués principalement d’anarcho-syndicalistes de la F.S.F., deux postes de responsabilité étant attribués à un militant de la F.S.F., et la Bataille syndicaliste présentant de nombreux articles de Pierre Besnard. La prise en main de ces C.D.S. par les anarcho-syndicalistes se renforce d’autant plus qu’au début de novembre 1945, les trotskistes quittent ces comités. Cette rupture n’aurait pas eu lieu à propos de divergences idéologiques, mais de la question de l’adhésion ou non à ces C.D.S. de “camarades qui ne seraient pas de la C.G.T. ou la quitteraient” [6]. Les anarcho-syndicalistes, majoritaires, refusaient l’obligation pour les membres des C.D.S. de rester à la C.G.T. quoi qu’il arrive. Les trotskistes, mis en minorité, quittèrent alors ces C.D.S. pour se regrouper autour d’une publication mensuelle, Front Ouvrier [7].
Ainsi il existait deux organisations anarcho-syndicalistes au sein de la C.G.T. : la F.S.F., composée uniquement d’anarcho-syndicalistes, et les C.D.S. dominés par ces derniers. Leur travail d’opposition à la direction cégétiste fut brisée par la nette prédominance des communistes. C’est au congrès du congrès de la C.G.T. d’avril 1946 que la scission se montra inévitable. Lors de ce congrès on assista à un écrasement des minorités elles-mêmes divisées. Pour réduire ces minorités au silence, le bureau confédéral et la commission administrative de la C.G.T. ont imposé que seuls les syndicats d’au moins 5000 adhérents soient représentés directement au congrès. Les petits syndicats écartés seraient représentés indirectement par les grands. Ce sont les communistes qui détiennent la direction de ces grands syndicats. C’est donc avec une majorité d’environ 4/5 des voix que les communistes l’emportent à ce congrès. A la suite du congrès, l’Action syndicaliste du 1er mai 1946 reproche aux chefs de la minorité F.O., représentée par Léon Jouhaux, d’avoir accepté des postes de direction de la C.G.T. : “Ils ont placé leur souci de conserver leurs fonctions au-dessus de leurs convictions personnelles et de leur honneur de militants”.
Les nouveaux statuts votés lors de ce congrès mettent fin à la démocratie au sein de la C.G.T., mais également à son indépendance vis-à-vis du P.C.F. Pour la F.S.F., la C.G.T. “n’est plus qu’un instrument d’oppression économique, au service d’un parti et d’un gouvernement communo-socialiste.[…] Elle ne sera plus la C.G.T. défendant les droits des travailleurs, orientant son action vers les fins traditionnelles du syndicalisme”. Le titre de ce numéro d’Action syndicaliste résume à lui seul la pensée de la F.S.F. : “La C.G.T. est morte, la C.G.T.U. lui succède” [8]. Il devenait dès lors impossible pour les anarcho-syndicalistes de rester au sein de cette C.G.T.
L’unité syndicale dans la C.G.T., qui avait été souhaitée par les anciens de la C.G.T.S.R. dans leur appel du 15 septembre 1944, ne dura ainsi guère plus d’un an. Toujours dans ce même numéro, la F.S.F. annonce la conférence de mai pour constituer la C.N.T. Avant même qu’elle soit constituée, il est déjà décidé qu’elle adhérera à l’A.I.T., tout comme l’avait fait la F.S.F. [9]. Il faut cependant noter que cette décision de quitter la C.G.T. ne faisait pas l’unanimité parmi les membres de la F.S.F. Aimé Capelle, par exemple, était favorable au fait de rester à la C.G.T. pour ne pas briser l’unité syndicale, mais aussi parce que l’échec de la C.G.T.S.R. était encore présent dans les esprits [10].
b) La constitution de la C.N.T. (mai 1946- décembre 1946)
La conférence de mai, appelée par la commission administrative de la F.S.F., se déroula sur deux jours : le samedi 4 mai se tinrent les séances avec pour unique ordre du jour le problème syndical [11], et le 5 mai les C.D.S. organisaient une conférence à laquelle étaient conviés tous ceux qui voulaient défendre l’indépendance syndicale et la liberté du syndicalisme. Lors de cette conférence, il fut donc décidé de dissoudre les C.D.S. et la F.S.F. pour créer la C.N.T. Les participants à cette conférence écrivirent un “aux travailleurs français”. On retrouve dans ce manifeste la thématique anarcho-syndicaliste et la dénonciation de la C.G.T. On peut supposer que Pierre Besnard a participé à sa rédaction, ou du moins l’a fortement influencée [12], dans la mesure où il est question de créer “l’organisation de la Confédération générale des consommateurs”. Ce désir d’organiser les consommateurs en parallèle d’une organisation des producteurs, le syndicat, est en effet un des points essentiels de la théorie de Pierre Besnard. On peut noter aussi la large place qu’accorde ce manifeste à la solidarité pour “notre sœur, la Confédération Nationale du Travail d’Espagne, contrainte à l’exil par Franco.”
Le siège de la C.N.T. fut (potentiellement) le même que celui de la F.S.F., au 22, rue Sainte-Marthe dans le dixième arrondissement de Paris [13]. Il s’agissait d’un local prêté par Julien Toublet, un des fondateurs de la C.N.T. Dans l’attente du congrès constitutif qui devait se tenir les 7, 8 et 9 décembre 1946, l’activité de la commission administrative (C.A.) et du bureau confédéral (B.C.) consistait à faire connaître le plus largement possible la C.N.T. La C.A. se divisa en deux commissions : une commission de propagande composée de Aimé Capelle, Souchay, Jacquelin, Geuffroy, Dimanche, Marie Giraud et Eugène Juhel, et une commission d’organisation chargée d’établir une structure et de préparer le congrès. Frament, Snappe, Zwikel, Lentente, René Doussot et Julien Toublet [14] ont participé à cette commission. Si la naissance de la C.N.T. a été relativement bien relayée par la presse (publications de communiqués de presse ; Radio-Luxembourg informant de sa création à trois reprises ; venue “de nombreux journalistes français et étrangers” au siège de la C.N.T.), ce travail de propagande reste néanmoins limité en raison du manque de fonds. Le manifeste aux travailleurs français ne fut édité qu’à 1000 exemplaires, et seulement 60 000 tracts confédéraux ont été tirés, sans compter cependant les initiatives locales. L’Action syndicaliste parvient à être publié -difficilement- grâce aux fonds de la Bataille syndicaliste qui avait disparu après la dissolution des C.D.S. Le journal reçoit d’ailleurs en soutien de la part des syndicats et d’individus, entre mai et novembre 1946, plus de 58 300 francs dont une bonne partie provient des syndicats S.U.B. et métaux de Paris [15]. A ce matériel de propagande, il faut ajouter la propagande orale. Les membres du B.C. et de la C.A. tinrent en effet plusieurs réunions publiques dans la région parisienne ainsi qu’en province et dont le bilan fut positif. Les circulaires confédérales envoyées aux différents groupes témoignent d’un certain enthousiasme quant à l’avenir de la C.N.T. : “Notre C.N.T. rencontre un succès inespéré qui dépasse largement tous les espoirs que nous avions fondés. […] de toutes parts […] de tous les milieux affluent des demandes de renseignement ou d’adhésion”. [16] Selon Aimé Capelle, “il y avait la queue” devant le siège, “les gars venaient se renseigner”. Pour satisfaire cet “afflux”, la C.A. désigna deux permanents, Capelle et Juhel. Ce dernier fit aussi état dans son rapport du problème de pénurie de cartes confédérales du fait des nombreuses demandes d’adhésion. Si cet enthousiasme se retrouve dans les témoignages et les archives confédérales, il est cependant difficile de mesurer la réalité de ce succès. Un rapport rédigé par l’union locale de Bordeaux à l’occasion du congrès de 1949, contredit ce succès : “En mai 1946, la F.S.F. se déclare constituée en Confédération Nationale du Travail. Le fait passa à peu près inaperçu parce que la F.S.F. n’avait pas su prendre place dans la C.G.T.”. Cette remarque semble excessive tout comme pouvait l’être l’enthousiasme de la C.A. Il est en revanche certain que la naissance de la C.N.T. ait suscité un intérêt, une curiosité chez les travailleurs. En effet, le journal Force Ouvrière, de la tendance du même nom, du 23 mai 1946, relate cet intérêt des travailleurs pour la C.N.T. : “Certains de nos correspondants se sont émus de divers communiqués parus dans la presse et consacrant la naissance de la nouvelle centrale syndicale, la Confédération Nationale du Travail […]”.
Or si cet intérêt pour la C.N.T. fut réel et s’il y eut de nombreuses adhésions, il faut cependant noter que celles-ci étaient parfois des erreurs dues à un manque d’information sur ce qu’était la C.N.T. Aimé Capelle, dans son témoignage, affirmait à ce propos que certaines demandes d’adhésions venaient d’adhérents d’une C.N.T. qui avait existé avant la guerre et qui “était une organisation de jaunes”, ou bien encore des individus exclus de la C.G.T. pour avoir participé à la Charte du Travail sous Vichy. Ces syndicalistes n’adhérèrent bien entendu jamais à la C.N.T. et créèrent par la suite la Confédération du Travail Indépendante dont l’organe était Travail et Liberté.
Après sept mois d’organisation, de structuration, se déroule le congrès constitutif de la C.N.T. tenu à Paris, à la salle Susset dans le dixième arrondissement, les 7-8 et 9 décembre. Les différents rapporteurs pour ce congrès sont Eugène Juhel pour l’activité de la C.A. et du B.C., René Doussot pour la trésorerie, Pierre Besnard pour la “Charte du syndicalisme révolutionnaire” et l’A.I.T., Jacquelin pour les salaires et la durée du travail et enfin Bezard pour la question agraire. Le congrès est peu important en soi. Il ne fait qu’officialiser l’existence de la C.N.T. Il est cependant nécessaire de s’arrêter sur la Charte du syndicalisme révolutionnaire, dite “de Paris”, étant donné qu’elle définit l’orientation de la C.N.T., sa nature et ses rapports avec les autres organisations ouvrières. Cette Charte de Paris n’est en réalité qu’une copie conforme de la Charte de Lyon de la C.G.T.-S.R. [17]. Cette copie confirme l’idée que la C.N.T. n’est que la continuité de la C.G.T.S.R. Pour autant, dans cette charte, il n’est pas fait référence à la C.G.T.S.R. et à sa charte de Lyon mais à la charte d’Amiens. Si “la C.N.T. est la continuation de la C.G.T. de 1906” [18], c’est-à-dire qu’elle se réclame de la charte d’Amiens, la charte de Paris renforce néanmoins l’hostilité du syndicalisme à l’égard des partis politiques et ne se limite pas à la simple notion d’indépendance du syndicalisme. En outre, la C.N.T., qui se présente comme la seule véritable organisation révolutionnaire, refuse l’unité avec les autres organisations syndicales sur le terrain révolutionnaire : “[…] il est indéniable que toute conjugaison de ces mêmes forces pour une lutte révolutionnaire apparaît inutile et vaine en raison de l’opposition fondamentale des buts que se sont assignées les diverses factions du syndicalisme”. Elle reconnaît en revanche la possibilité de réunir les différentes organisations syndicales “dans une action corporative”, “sur le terrain de l’action quotidienne” ; autrement dit, la C.N.T. se prononce pour l’unité à la base, mais contre l’unité au sommet [19]. Autre point important de cette charte, c’est celui sur la “collaboration de classe” : “condamnant la “collaboration des classes” et le “syndicalisme d’intérêt général”, […], le Congrès précise que la collaboration des classes est caractérisée par le fait de participer, dans des organismes réunissant des représentants des ouvriers, des patrons ou de l’État, à l’étude en commun des problèmes économiques dont la solution apportée ne saurait que prolonger, en la renforçant, l’existence du régime actuel”.
Ce passage présente une sorte de consensus entre ceux qui sont pour les différentes élections professionnelles (délégués du personnel, comités d’entreprises) et ceux qui y sont opposés. Le fait de préciser “…à l’étude en commun des problèmes économiques…” permet ainsi aux partisans de ces élections de s’y présenter puisqu’elles sont censées défendre les travailleurs. Ce point de la charte limite par cette précision la collaboration de classes aux organismes tels que le Bureau International du Travail, ou aux discussions sur les conventions collectives nationales. Malgré la liberté laissée aux syndicats de se présenter à ces élections professionnelles, les organismes tels que les Comités d’entreprises sont condamnés.
En ce qui concerne l’organisation, déterminée par les statuts, la C.N.T. réunit les syndicats en congrès tous les deux ans. Pendant cette période, elle est administrée par une Commission administrative et par le Bureau confédéral qui s’occupe entre autres de la gestion du nouvel organe, le Combat Syndicaliste (n°1, avril 1947). Dans l’attente du congrès, les unions régionales et les fédérations se réunissent en comité confédéral national (C.C.N.). Ses statuts ont surtout un intérêt dans la mesure où ils rendent impossible une éventuelle prise de pouvoir au sein de l’organisation. Le Bureau Confédéral qui “est l’agent d’exécution et de liaison de la C.N.T.”, selon les statuts, ne peut en effet dépasser le rôle qui lui est attribué. S’il cherchait à imposer une quelconque ligne politique, “il peut être suspendu par un C.C.N.”. Ce C.C.N. consistant à réunir les Unions Régionales, un groupe qui chercherait à prendre le pouvoir devrait alors avoir conquis toutes les régions. La volonté de rendre impossible une prise de pouvoir est également affirmée par ce principe que “chaque Syndicat représenté au Congrès dispose d’une voix” quelque soit son nombre d’adhérents. Il ne suffit donc pas de conquérir les gros syndicats qui disposeraient de plusieurs voix pour avoir le pouvoir au sein de la C.N.T.
Pendant cette première année d’existence, la C.N.T. s’est consacrée principalement à son organisation, à sa structuration. Il faut attendre l’année suivante pour qu’elle connaisse une activité réellement syndicale, lui permettant de se développer.
c) Une croissance rapide (1947-1949)
Dès son congrès, la C.N.T. met en place une structure confédérale composée de sections d’entreprises, de fédérations, d’unions locales et d’unions régionales. Celles-ci montrent d’ailleurs que la C.N.T. est implantée sur tout le territoire national puisqu’elles sont au nombre de 22. Sur le plan géographique, la C.N.T. semble principalement implantée dans les régions parisienne, bordelaise et Midi-Pyrénées. Les soixante-trois syndicats représentés au deuxième congrès confédéral sont répartis sur trente-trois villes, dont treize dans le sud. A Paris, où la C.N.T. s’est le plus développé, on compte une douzaine de syndicats [20]. A ce même congrès, les principales villes après Paris, à savoir Bordeaux, Toulouse et Marseille comptent respectivement sept, cinq et quatre syndicats. Si dans quelques régions la C.N.T. connaît une solide implantation, son existence est en revanche éphémère dans certaines localités. Cela est parfois dû au fait que ces unions locales ont été créées par des exilés espagnols comme par exemple à Alger [21] et à Tours. Mais l’absence d’adhérents français a fait que ces espagnols ne purent continuer à animer seuls ces sections avec le risque d’expulsion.
Sur le plan professionnel, ce sont les secteurs des métaux, du bâtiment et des cheminots qui ont connu le plus grand développement. Toujours à ce congrès, sont représentés douze syndicats des métaux, dix du bâtiment et cinq de cheminots (les six de Paris étant considérés comme un). Ces trois secteurs ont d’ailleurs chacun leur presse. La Fédération des Travailleurs du Rail (F.T.R.) dispose du Rail enchaîné [22] (n°1, février 1947). Entre 1947 et 1949, Raymond Beaulaton est secrétaire de la F.T.R. et de l’I.T.R. (Internationale des Travailleurs du Rail, affiliée à l’A.I.T.). Selon Beaulaton [23], cette fédération aurait été la plus importante. Lors du conseil national de la F.T.R., le 16 mai 1948 à Paris, 110 syndicats sont représentés, chiffre qui serait encore inférieur à la réalité si l’on en croit le compte-rendu : “[…] s’étonne de ne voir que 110 syndicats représentés […]”. La fédération industrielle des métaux dispose quant à elle d’un organe trimestriel, C.N.T.-Métallurgie. En réalité, cet organe fédéral est soutenu par le syndicat industriel des métaux de la région parisienne (S.I.M.R.P.) qui est le principal syndicat de cette fédération. Le S.I.M.R.P. publie aussi un périodique, Action directe (n°1, avril 1947). Les secrétaires de cette fédération entre 1947 et 1950 sont successivement Jacquelin, Edouard Rotot et Rabret. Outre ces trois responsables, on peut également citer René Doussot, Le Bot et Maurice Joyeux qui appartiennent au conseil syndical des métaux. Enfin, la troisième fédération, celle du bâtiment, ne publie pas de journal confédéral. Seul le S.U.B. de Paris sort un bulletin, S.U.B., “mensuel du Syndicat Unifié du Bâtiment et des travaux publics de la région parisienne” (n°1, avril 1948). En 1950, ce journal n’est plus qu’un supplément du Combat syndicaliste. Si la C.N.T. a pu s’implanter dans certains secteurs professionnels, il faut préciser en revanche que de nombreux syndicats ne sont que des unions locales désignées comme telles ou comme intersyndicales et syndicats inter-corporatifs. Ces syndicats interprofessionnels sont au nombre de douze lors du congrès de 1948.
Cette implantation géographique et professionnelle ne permet pas pour autant d’évaluer les effectifs de la C.N.T. S’ils sont importants, il est en revanche excessif d’évaluer ses adhérents à 100 000 en 1947 et 200 000 pour 1948 [24]. Ces évaluations sont dues au “bluff” du bureau confédéral : “Le bureau confédéral est l’initiateur d’une politique de bluff […]. Exemple : le sous-secrétariat de l’A.I.T. […] a envoyé à l’A.I.T. un rapport officiel, dont JACQUELIN a reconnu être l’inspiration, et qui déclare officiellement que la C.N.T. dépasse 25000 adhérents pour la seule région parisienne. De tels procédés sont inacceptables et dangereux” [25]. Une autre évaluation, celle de Hamelet [26] semble plus réaliste : entre 45 000 et 125 000. Si les adhérents se comptent en milliers, il est probable que de nombreuses adhésions ne furent que passagères. Prenons l’exemple de la sixième U.R. (Midi-Pyrénées). Différents courriers ou compte-rendus de congrès régionaux témoignent de plusieurs milliers d’adhérents. En 1947, dans une lettre adressée à Mirande, secrétaire de cette U.R., l’U.L. de Carcassonne écrit ceci : “Cher camarade, comme suite à nos conférences tenues à Carcassonne, j’ai l’avantage de te demander 500 cartes […]. Veuille noter que ce chiffre est inférieur à nos effectifs et que nous comptons d’ores et déjà sur 3000 cartes pour 1947”.
Ces adhésions ne témoignent pas de convictions anarcho-syndicalistes, elles correspondent plus à un “feu de paille” et sont de courtes durées. Ces 3000 adhérents potentiels ne se retrouvent d’ailleurs pas l’année suivante. En effet, lors du troisième congrès de la 6ème U.R. tenu à Perpignan, le 19 décembre 1948, le rapport de la trésorerie fait état de 5400 cartes dont 4530 rien que pour le syndicat du bâtiment de Toulouse [27]. Ces deux indices montrent bien que les effectifs de la C.N.T. ne sont pas continus.
Les adhérents venus à la C.N.T. sont certainement des syndicalistes déçus par la C.G.T. Comme le note Xavier Frolan [28], “en 1946, un militant de gauche n’a le choix qu’entre deux organisations pour se syndiquer : la C.G.T.-de plus en plus prise en main par le P.C.- et la C.N.T. ! Tous ceux qui sont allergiques au P.C. […] ont tendance à rejoindre la C.N.T.”. Ces adhérents ne sont pas venus à la C.N.T. par adhésion aux idées anarcho-syndicalistes, mais par un anti-communisme d’une part, et d’autre part parce que la C.N.T. est la seule centrale à ne pas modérer ses revendications qui sont principalement le retour à la semaine des 40 heures dans un premier temps puis l’opposition à la prime au rendement et “attribution aux travailleurs d’un ravitaillement réellement vital”, propositions qui sont à cette période relativement bien reçues.
Ces nombreuses adhésions peuvent également trouver leur explication dans le climat social de 1947, année qui connut de nombreuses grèves auxquelles la C.N.T. a parfois participé. Les secteurs où l’on trouve des traces de la participation de la C.N.T. sont essentiellement ceux de la métallurgie et des cheminots. Dans la métallurgie, on peut noter les grèves aux usines U.N.I.C. en juin à Puteaux [29] (Hauts-de-Seine), mais surtout celle de la Régie Renault en avril. Selon un article du Mouvement social [30], la C.N.T. aurait été absente lors de cette grève. Elle se serait implantée à la R.N.U.R. seulement en novembre pour “faire un peu de publicité sur son syndicat”. L’auteur de cet article ne s’appuie que sur les archives de la R.N.U.R. qui témoignent en effet d’un dépôt de statuts pour créer un syndicat C.N.T. à la direction le 4 novembre par Rotot, secrétaire du S.I.M.R.P. Or dans Action directe de mai 1947 un article relate au contraire l’action de la C.N.T. pendant la grève d’avril. S’il n’existait pas en avril de syndicat C.N.T. en terme de statut à la R.N.U.R., les syndiqués C.N.T. travaillant dans cette usine ont en revanche participé à la grève avec comme mot d’ordre “unité d’action encore plus parfaite” tout en dénonçant le caractère politique de la C.G.T. liée au P.C.F.
La C.N.T a également participé aux grèves des cheminots de juin. Cette grève est née avec des arrêts de travail à Villeneuve-Saint-Georges où les “ouvriers qui n’avaient pas pu se procurer le pain pour leur casse-croûte eurent décidé de cesser le travail” [31]. Si Vincent Auriol a vu dans ces arrêts de travail spontanés l’action souterraine de militants anarchistes [32], cette suspicion paraît justifiée. On peut en effet penser que la C.N.T. est l’instigatrice de la grève. Cette hypothèse se vérifie si l’on prend en compte les témoignages de Raymond Beaulaton : “A l’été 1947, sous l’impulsion du petit syndicat C.N.T., les cheminots de Villeneuve-Saint-Georges se mettent en grève, grève qui devait rapidement s’étendre à tout le pays.” Cependant, il paraît difficile d’expliquer l’ampleur du mouvement par la seule action de la C.N.T. Cette ampleur tient plus au fait que “des cheminots de plus en plus nombreux se soient lassés de l’attitude attentiste de la C.G.T., qui a soutenu les exhortations gouvernementales en faveur de la production […]” [33]. La F.T.R. fit l’éloge de cette grève dans le Combat syndicaliste [34] et félicita l’action spontanée des cheminots qui ne se sont pas préoccupés des “bonzes et fonctionnaires cégétistes”. Dans ce même numéro, la F.T.R. dénonce aussi la tentative des communistes de politiser la grève : “Un des faits les plus caractéristiques de la grève des cheminots est l’attitude des politiciens, communistes et socialistes. Les premiers ne sont pas pour la grève. Ils étaient contre, en apparence du moins. Au fond, ils sont bien contents qu’elle gêne le gouvernement Ramadier. Ils espèrent même qu’elle servira à le jeter bas. Ils désirent l’exploiter dans les coulisses.”
Cette dénonciation de la politisation de la grève réapparaît lors des grandes grèves de novembre. Alors que la grève continuait à s’étendre pour devenir quasi-générale les 28 et 29 novembre, les cheminots de la C.N.T. signèrent avec la C.F.T.C., la C.G.C., le C.A.S. et le S.P.I.D. une déclaration commune pour protester contre l’utilisation à des fins politiques du mécontentement des cheminots et réclamer la liberté du travail. La C.N.T., au niveau confédéral, avait déjà pris position contre la grève politique avant que le mouvement ne prenne cette ampleur. En effet, dans une circulaire confédérale datée du 20 novembre 1947, le B.C. et la C.A. expliquaient les objectifs politiques de ces grèves pour la C.G.T. et le P.C.F. Elle ne s’oppose pas à la grève en tant que telle mais à sa politisation. Le mouvement de grève étant largement suivi par les cheminots, la C.N.T. se devait de nuancer ses propos afin de ne pas apparaître comme un syndicat de “jaunes”. Cette nuance se retrouve dans un tract signé avec F.O. (qui est encore une tendance de la C.G.T.), C.F.T.C. et la Fédération syndicaliste des P.T.T. ayant pour mot d’ordre “OUI à la grève revendicative, NON pour l’agitation politique”.
Si la C.N.T. parvient à s’implanter dans certains domaines, cela tient certainement plus à ses activités là où elle est implantée qu’à son discours jusqu’au-boutiste, refusant tout compromis.
d) Un discours radical
Les contenus des revendications et des mots d’ordres de la C.N.T. sont assez originaux dans la mesure où tout ce qui est considéré comme des acquis sociaux pour les travailleurs est rejeté par la C.N.T. Qu’il s’agisse des conventions collectives, de l’institution des comités d’entreprises ou bien encore de la création de la sécurité sociale, toutes ces réformes sont perçues comme des moyens pour l’État et le patronat d’intégrer les organisations syndicales dans leurs organismes de “collaboration de classes”, et qui en conséquence freinent toutes actions revendicatives.
Commençons par les conventions collectives. Ces dernières limiteraient toute action revendicative des travailleurs puisqu’elles résultent des négociations entre l’État, le patronat et les organisations syndicales. Étant le fruit de négociations au sommet, les conventions collectives échappent donc au contrôle de la base. A ces conventions collectives, la C.N.T. préférait “les conventions particulières”, c’est-à-dire des conventions propres à chaque entreprise. Ces conventions particulières étaient pour la C.N.T. “la conclusion d’un épisode restreint de la lutte des classes, sa matérialisation” [35]. Les différentes situations engendrées par des conventions propres aux entreprises, permettaient selon la C.N.T., de stimuler l’action ouvrière dans une entreprise pour atteindre une meilleure situation existant ailleurs. Ces différentes luttes constituent une “auto-éducation révolutionnaire des travailleurs” [36]. Le principal reproche que la C.N.T. adresse à ces conventions collectives, c’est qu’elles freinent la capacité révolutionnaire des travailleurs. Elles détournent ces derniers de l’action revendicative, dont la grève en est la manifestation, en intégrant les syndicats à la table des négociations. Or, pour la C.N.T., ces négociations autour des conventions collectives ne sont ni plus ni moins qu’une abdication des organisations syndicales face au patronat et à l’État. Dans l’esprit de la C.N.T. il est impossible de se dire révolutionnaire et d’accepter en même temps de négocier. Ces négociations représentent aux yeux des militants anarcho-syndicalistes la négation de la lutte des classes. Les conventions “n’ont pour but que la pérennité du régime capitaliste” [37], dans la mesure où elles légitiment le profit en fixant une parité entre ce dernier et les salaires.
L’autre réforme qui vise à limiter une hypothétique poussée révolutionnaire des travailleurs est l’institution des comités d’entreprises. Ces comités d’entreprises ne sont pour la C.N.T. qu’un instrument pour intégrer les syndicats à la gestion de l’entreprise. Or, dans une économie capitaliste, participer à la gestion d’une entreprise qui tire son profit du travail salarié traduit aux yeux de la C.N.T. la « collaboration de classes ». Par ailleurs, puisque les délégués au comité d’entreprise n’ont aucun pouvoir décisionnel, ils ne servent à rien, sinon à leurrer les travailleurs. Seules l’action directe et la grève peuvent exercer une pression sur l’employeur. Dans son article intitulé “A bas les comités d’entreprises !” [38], Henri Bouyé résume la vision de la C.N.T. : “Il n’y a pas de demi-mesures : ou bien la transformation sociale est réalisable par étapes, et alors le Comité d’Entreprise pourrait être une bonne chose, il faudrait y entrer. Ou bien, tout compromis avec la bourgeoisie possédante et l’État retarde cette transformation, et la Révolution demeure la seule voie de libération pour le peuple. Le syndicalisme révolutionnaire ne saurait emprunter une autre voie que cette dernière. Les militants n’iront pas se pourrir dans des organismes dont la constitution, en fin de compte, prolonge la durée d’une exploitation du travail à laquelle ils font la guerre.”. Cependant, au congrès de 1950, la participation aux Comités d’Entreprises est tolérée. Le congrès se prononce en effet pour une “participation circonstancielle laissée au contrôle des U.L.” [39]. Toujours à ce congrès, la C.N.T. se prononce par ailleurs pour la participation aux élections de délégués du personnel, ces élections ne constituant pas pour autant un but en soi et la participation à celles-ci ne devant donc pas être systématiques. Il est à noter enfin que dans les articles relatifs à ces comités d’entreprise il n’est jamais fait allusion aux comités mixtes à la production ou comités de gestion qui se sont instaurés à la Libération [40], excepté un article consacré aux Usines Berliet [41]. Les Usines Berliet ont été une des principales usines où a été établi un comité de gestion [42]. Or, dans cet article, la C.N.T. [43] nie l’idée selon laquelle il y aurait eu une gestion ouvrière. Le silence de la C.N.T. sur les autres expériences de comités de gestion pourrait s’expliquer par sa critique du modèle des Usines Berliet. Il est en effet possible que sa critique de ce modèle se généralise à tous les autres [44].
Enfin, la dernière et principale réforme de l’après-guerre à laquelle s’oppose la C.N.T., est la création de la sécurité sociale. En la critiquant, la C.N.T. se distingue des autres organisations ouvrières pour qui la sécurité sociale est une manifestation de la solidarité entre les travailleurs. Elle refuse l’intervention de l’État dans la gestion des caisses : celles-ci ne doivent être gérées que par les travailleurs. La C.N.T. s’oppose également à l’idée que les travailleurs devraient cotiser à ces caisses, ces cotisations devant être pour elle à la charge des employeurs.
L’attitude de la C.N.T. à l’égard de ces réformes témoigne de son refus de tout compromis avec l’État et le patronat. Elle adopte un discours radical qui exclut toute possibilité d’entente. Ce discours s’inscrit dans la continuité du rejet de l’idée d’intérêt général, qui sous-entend la possibilité, par le biais de négociations, de satisfaire les intérêts des employeurs et des travailleurs. Ces différentes réformes ne représentent donc en rien une amélioration ou un acquis social pour les travailleurs. Si la C.N.T. rejette ces réformes, elle n’oublie pas pour autant que le syndicalisme doit œuvrer quotidiennement pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Elle se positionne en effet pour le retour immédiat aux quarante heures (les horaires hebdomadaires pouvant atteindre parfois les cinquante heures, voire plus), et pour la semaine de trente heures un second temps ; pour une hausse des salaires, mais une hausse qui doit être uniforme, c’est-à-dire qui ne doit pas établir de hiérarchie entre les travailleurs. La hiérarchie des salaires est aussi un thème combattu par la C.N.T. Non seulement, elle est un facteur de division, mais d’un point de vue économique elle provoque une baisse du pouvoir d’achat des plus pauvres, suite à la hausse des salaires d’une partie des travailleurs qui engendre une hausse des prix. Cette hiérarchisation des salaires est un moyen de hiérarchiser les emplois entre eux. Or, selon les anarcho-syndicalistes, la hiérarchisation des emplois ne repose sur aucun critère. C’est dans cette logique que la C.N.T. réclame l’égalité économique qui ne peut se réaliser dans l’immédiat que par “des augmentations uniformes en fonction de l’indice des prix” [45].
Dans la mesure où, pour la C.N.T., le climat social de la fin des années quarante peut basculer à tout moment en crise révolutionnaire, la participation des autres syndicats à ces organismes constitue une capitulation et une trahison des buts poursuivis par le syndicalisme révolutionnaire tels qu’ils sont inscrits dans la charte d’Amiens, à savoir l’expropriation du capitalisme et la prise en main des moyens de production par la grève générale.
Malgré son discours radical, la C.N.T., dès sa création, a su s’implanter dans le champ syndical français, en sachant profiter du climat social, et de la situation syndicale puisqu’elle était la seule centrale syndicale révolutionnaire en dehors de la C.G.T. Elle espérait d’ailleurs -compte tenu de cette situation- attirer à elle les syndicats autonomes. Mais la naissance de la C.G.T.-F.O. changea la donne et posa à nouveau le délicat problème de l’unité syndicale.
2- Unité syndicale ou unité des syndicalistes révolutionnaires ? (1946-1950)
Il est important de consacrer une partie à ce thème de l’unité syndicale, dans la mesure où il anima la vie confédérale dès 1947 et plus particulièrement à partir de la fin de 1948. Le problème de l’unité syndicale se pose à la C.N.T. dans un premier temps avec les syndicats autonomes qu’elle espère intégrer. Mais la création de Force Ouvrière mit fin aux espoirs de la C.N.T. : elle étendra le problème de l’unité syndicale à tous les syndicalistes hostiles à la C.G.T. et se réclamant de l’indépendance du syndicalisme. Nous verrons alors que l’unité provoqua au sein de la C.N.T. des divergences théoriques, aboutissant même à des exclusions.
a) Rapports entre la C.N.T. et les autonomes (1947-1948)
Les syndicats autonomes se sont créés pour les mêmes raisons que la C.N.T. : ils refusaient la main-mise des communistes sur la C.G.T. Mais au lieu de se confédérer, ces syndicats ont préféré l’autonomie. Les principaux syndicats autonomes sont la Fédération syndicaliste des P.T.T. dirigée par Mourguès, le Comité d’action syndicaliste (C.A.S.) des cheminots créé en juillet 1947 avec Laurent, et le C.A.S. des métaux mené par Racine.
Le Comité Confédéral National (C.C.N.) du 2 novembre 1947 avait mandaté les membres du B.C. pour engager des pourparlers avec les autonomes. Ces entrevues n’aboutirent jamais à une adhésion de ces syndicats à la C.N.T. Selon l’U.L. de Bordeaux, “l’échec fut total” [46]. En effet, lors de la dernière entrevue avec la fédération syndicaliste des P.T.T., le 24 décembre 1947, celle-ci déclare qu’elle a donné son adhésion à F.O. Toujours dans ce même mois, le B.C. rencontra les représentants de la fédération autonome des cheminots ; rencontre qui n’aboutit à aucun résultat. Le seul fait positif serait une déclaration commune entre les représentants du syndicat C.N.T. des métaux, Rotot, Salembier et Coutelle, et ceux du C.A.S. des métaux, Kléhamer, Racine et Juliot, réunis le 24 décembre [47]. Dans un communiqué, ces représentants déclarent que “les délégués décident de consulter leurs organisations propres en vue de constituer un comité de coordination pour préparer et réaliser l’unité organique”. Or cette unité organique ne se réalisa jamais. Le B.C. avait cependant tenté de renouveler les pourparlers avec le syndicat autonomes des métaux de Paris, au mois de juillet 1948, mais “les relations sont en sommeil” [48]. Il semble bien que la scission de décembre 1947 qui donne naissance à la C.G.T.F.O. (bien que son congrès constitutif n’ait lieu qu’en avril 1948) ait encouragé la C.N.T. à multiplier les pourparlers avec les autonomes.
La conclusion de ces différentes entrevues est que ces syndicats autonomes ne veulent pas adhérer à la C.N.T. Ils préfèrent entrer à F.O. et demandent d’ailleurs à la C.N.T. de faire comme eux. Lors d’une entrevue qui eut lieu le 2 janvier 1948 entre la C.N.T. représentée par Jacquelin, Juhel, Snappe et Fontenis, et les autonomes Hervé, Juliot et Racine, ces derniers déclarèrent qu’“ils avaient la ferme intention de faire du syndicalisme révolutionnaire dans leur organisation, et qu’ils espéraient bien faire éclater la nouvelle centrale, et ils nous demandèrent de nous joindre à eux dans F.O. pour les aider dans cette tâche” [49]. L’objectif des autonomes, du moins ceux des métaux, était de constituer, avec la C.N.T., un pôle syndicaliste révolutionnaire au sein de la nouvelle C.G.T.-F.O. qui proposait une unité syndicale englobant la C.N.T. [50]. A cette proposition, les représentants de la C.N.T. répondirent en se référant à la charte de Paris qu’ils ne pouvaient “entretenir des relations, avec d’autres confédérations, et encore moins apporter notre appui à la création d’une autre centrale ouvrière”. Dans cette circulaire confédérale, le B.C. et la C.A. sont également persuadés que “d’ici le congrès de F.O., beaucoup d’autonomes seront menés à se diriger non vers un syndicalisme de réformistes bureaucratiques, mais bien vers la C.N.T. qui restera la seule centrale du syndicalisme révolutionnaire”. La réalité étant toute autre, la C.N.T. dut se résigner à modérer ses propos.
Le 19 juin 1948, la C.N.T. se réunit avec des autonomes et des membres de F.O., et ils décidèrent “de constituer un comité de coordination qui serait chargé de préparer une conférence nationale d’unité syndicaliste” [51]. Par la suite, la C.N.T. opta lors de son C.C.N. tenu les 28 et 29 août 1948, pour la création de “d’action” mais uniquement sur le plan de l’entreprise. Il s’agit de reprendre l’idée de la charte de Paris, à savoir l’unité à la base et non au sommet. Le deuxième congrès confédéral tenu à Toulouse les 24, 25 et 26 septembre 1948 s’inscrit dans la continuité du C.C.N. et invite “les organisations de bases […] à former un comité de coordination avec ces syndicats (les syndicats autonomes)”. Cependant, la manière dont la C.N.T. pose la question du regroupement syndical peut paraître ambiguë pour les autres organisations syndicales. Nous reproduisons ici l’“appel au regroupement syndical” voté à ce congrès : “Le 2ème congrès de la C.N.T. considérant les difficultés de l’heure et la confusion existant dans tous les milieux syndicaux, appelle tous les travailleurs à se réunir dans une centrale affirmant comme base essentielle la conception de la lutte des classes avec, comme base d’action directe, pour la disparition du salariat et du patronat et la substitution des organismes syndicaux aux organismes d’Etat, (le 2ème congrès) s’adresse spécialement à tous les syndicats autonomes et minorités syndicales d’accord avec ces principes et finalités, pour se réunir à la C.N.T. pour la constitution de cette centrale”.
Cet appel au regroupement syndical est en réalité un appel au regroupement des syndicalistes révolutionnaires. La C.N.T. se considérant comme la seule centrale syndicaliste révolutionnaire, elle suggère ainsi que la place des syndicalistes révolutionnaires ne peut être qu’à la C.N.T. Il s’agit donc un appel aux syndicalistes révolutionnaires pour qu’ils adhèrent à la C.N.T. Cette position de la C.N.T., premier pas vers son isolement, est un des obstacles au regroupement syndical qui était l’objectif du Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste.
b) Le Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste (1948-1950)
Le comité national de coordination des syndicats autonomes avait appelé à une conférence nationale sur le thème du regroupement syndical, les 20 et 21 novembre 1948. La C.N.T. était représentée par Edouard Rotot et Maurice Joyeux. Étaient également présents à cette conférence la minorité F.O. représentée par Le Bourre, la tendance trotskiste de l’Unité Syndicale avec Pierre Lambert et l’École Émancipée, tendance de la F.E.N. Dans le compte-rendu de cette conférence, Rotot et Joyeux dénoncent tout d’abord la tendance de certains autonomes, notamment Racine, à faire l’éloge de l’association capital-travail. Ils estiment par ailleurs que la majorité des autonomes est “naïve”, “inculte aux idées progressistes”, ou bien encore que bon nombre d’entre eux sont des partisans de de Gaulle tel que Clément du syndicat autonome du métro. Le bilan que dresse la C.N.T. de cette conférence est nuancé. Outre la critique qu’elle fait des autres syndicats, elle constate une forte influence de l’Unité Syndicale. Cette tendance aurait modifié l’ordre du jour de la conférence qui était de débattre du regroupement syndical : “il (Pierre Lambert) est pour un comité d’action parce que ceci, par le jeu des fractions, permet à son parti de réaliser la direction unique du mouvement ouvrier minoritaire” [52]. Cette proposition de constituer un comité d’action était accueillie favorablement par les autres courants : les autonomes “pour ne pas être absorbés par la C.N.T.” [53], la minorité F.O. pour maintenir ses attaches à sa centrale et l’École Émancipée pour rester à la F.E.N. Le point positif, en revanche, est que la plate-forme adoptée par le comité d’action (qui devient alors le Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste) est très proche du syndicalisme révolutionnaire tel que l’entend la C.N.T. A l’issue de cette conférence, plusieurs comités locaux se mettent en place, en plus de ceux qui existaient déjà, auxquels la C.N.T. participe souvent.
Cependant, bien que des cartels régionaux se soient constitués, le Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste manquait de finalité, étant donné que l’unité organique était exclue. Pierre Monatte montre l’origine de cette absence d’unité : “[…]au fond, les différents courants syndicalistes révolutionnaires ne désirent pas tellement s’unir et se fondre. Chacun- autonomes, C.N.T., partisans de F.O.- restent convaincus d’avoir pleinement raison et de constituer le pôle de rassemblement” [54]. Ce constat se vérifie en particulier pour la C.N.T. Bien qu’elle eût espéré absorber les autonomes, elle reste partisane de l’unité d’action et non pas de l’unité organique.
Ce cartel n’ayant pas d’issue, la C.N.T. décida lors de son C.C.N. du 29 mai 1949 de rompre avec celui-ci tout en maintenant ses activités dans les comités locaux. Le motif de cette rupture serait “qu’il a compromis sérieusement la vitalité et l’unité de notre organisation” [55]. La raison véritable est certainement que la C.N.T. ne peut s’unir avec des éléments qu’elle juge réformistes et qu’elle a dû renoncer à l’adhésion des syndicats autonomes, qui était peut-être sa seule motivation pour participer à ce cartel. Cette décision du C.C.N. provoqua néanmoins une crise au sein de l’organisation, puisqu’elle allait à l’encontre de celle qui avait été prise au congrès confédéral de Toulouse. La 8ème U.R. (région de Bordeaux) menaçait de ne plus payer ses cotisations et le syndicat des métaux de Bordeaux envisageait même de quitter la C.N.T. Pour résoudre cette crise, il fut donc décidé de convoquer un congrès extraordinaire pour les 30, 31 octobre et 1er novembre 1949. Deux tendances vont alors s’opposer au sujet du Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste. Certaines sections comme la 6ème U.R. (Midi-Pyrénées) et la 8ème U.R. (région bordelaise) sont favorables au cartel, voire même à la création d’une centrale syndicaliste révolutionnaire, envisageant ainsi la fin de la C.N.T. Les partisans de l’unité et donc du cartel affirmaient qu’il fallait “envisager un regroupement syndicaliste révolutionnaire, sur des bases plus larges, pouvant être acceptées par tous les syndicalistes révolutionnaires” [56], autrement dit qu’il fallait faire des concessions. L’autre tendance qui est essentiellement celle de la 2ème U.R. (région parisienne) et de la C.A. et qui s’était prononcée pour le retrait de la C.N.T. du cartel, justifiait sa position par la faible présence de syndicalistes révolutionnaires au sein du cartel. Elle démontrait aussi l’inutilité du cartel, dans la mesure où l’unité organique envisagée était impossible pour la C.N.T. qui n’était favorable qu’à l’unité d’action à la base, celle-ci devant être de plus spontanée. Le congrès extraordinaire confirma la décision du C.C.N. de mai.
A la suite de ce congrès, certaines sections continuent leur activité au cartel (la 8ème U.R. et la F.T.R.) mais se verront obligés de le quitter. Seule la 8ème U.R. accepta de cesser ses activités au sein du cartel. Beaulaton et Robert, en revanche, en tant que représentants de la F.T.R., participèrent à la deuxième conférence nationale du cartel, les 12 et 13 novembre 1949. Cette participation témoignait d’une position opposée à celle de la C.A. La C.A. avait en effet décidé de déléguer à cette deuxième conférence nationale du cartel Samson du syndicat des transports et Toublet du syndicat des métiers d’art. Cette délégation avait pour mandat de “dénoncer la duperie que promet d’être la nouvelle centrale en gestation si jamais elle arrive à se constituer […]” [57]. Ainsi, lors du C.C.N. du 29 janvier 1950, les responsables de la F.T.R., Beaulaton, Robert, Pillerault et Regnault sont exclus de la C.N.T. pour non-respect des décisions votées lors du congrès confédéral [58]. Ces exclusions affaiblirent la F.T.R., puisque beaucoup de militants suivirent leurs responsables. Le thème de l’unité syndicale a donc divisé la C.N.T. et l’a certainement affaiblie. On peut supposer que des adhérents ont quitté la C.N.T. à cause de son intransigeance. Mais elle a été affaiblie aussi dans la mesure où elle s’est isolée du reste du mouvement syndical. Ce cartel lui avait en effet permis de nouer des contacts sérieux avec certains éléments. Pour des militants tels que Aimé Capelle, l’échec de l’unité est dû à l’intransigeance et à une position “anarchiste”, qui conduisent la C.N.T. à l’isolement.
3- La C.N.T. et l’anarchisme
Le syndicalisme révolutionnaire a toujours posé un problème : est-il anarchiste ? Ceux pour qui le syndicalisme révolutionnaire et l’anarchisme sont liés sont ceux qui ont créé auparavant la C.G.T.S.R. puis la C.N.T. [59]. Le caractère anarchiste est d’autant plus renforcé que beaucoup de militants cénétistes sont également à la Fédération Anarchiste (F.A.). Mais cette position ne faisant pas l’unanimité la C.N.T. fut divisée en deux tendances dès 1946.
a) Évolution des rapports entre la C.N.T. et la F.A. [60]
La F.A. manifeste son soutien à la F.S.F. puis à la C.N.T. dès son congrès de Paris, les 6 et 7 octobre 1945. Ce congrès qui regroupait toutes les tendances de l’anarchisme, tous “ceux qui se réclament de l’anarchisme et de l’anarcho-syndicalisme” avait pour objectif de donner une cohésion au mouvement libertaire dans son ensemble et de mettre fin aux discussions entre “des fractions qui hier, s’ignoraient ou se heurtaient” [61]. Lors de ce congrès, la F.A. demanda à ses militants d’adhérer à la F.S.F. Puis en 1946, alors que la F.A. avait été dans un premier temps hostile à la création de la C.N.T. qui mettait fin à l’unité des travailleurs, elle change d’attitude lors de son congrès qui se tient à Dijon les 13, 14 et 15 septembre 1946. Elle y affirme son soutien à la C.N.T. mais sans rendre obligatoire l’adhésion à celle-ci. Ce soutien se traduit entre autre par la rubrique syndicale du Libertaire largement ouverte à la C.N.T qui multiplia ses appels à quitter la C.G.T. pour venir la rejoindre. Cependant à partir de son congrès d’Angers qui se tient les 11, 12, 13 et 14 novembre 1948, la F.A. modifie sa position à l’égard de la C.N.T. La F.A. “s’affirme partisan de la réunion de toutes les organisations vraiment syndicalistes : C.N.T., syndicats autonomes, minorités F.O. ou C.G.T. […]”.
Si la C.N.T. a pu bénéficier dans un premier temps du soutien de la F.A., le départ de la C.N.T. du cartel provoque une prise de distance. Des militants de la F.A. tel que Maurice Joyeux [62] décident alors de quitter la C.N.T. pour adhérer à F.O. Les militants de la F.A. avaient en fait adhéré à la C.N.T. parce qu’elle était la seule centrale à se réclamer de la charte d’Amiens en dehors de la C.G.T. Ainsi, n’étant pas anarcho-syndicalistes, ils préférèrent adhérer à F.O. qui leur semble plus apte à réaliser l’unité des travailleurs tout en respectant l’indépendance du syndicalisme.
Mais la rupture intervient avec la montée du courant de Georges Fontenis. Le congrès régional du midi à Narbonne en janvier 1949 adopte des résolutions ne pouvant que provoquer la rupture : “la structure de la F.A. ne lui permet pas d’entraîner l’ensemble des travailleurs dans une action révolutionnaire. C’est à la C.N.T. que ce rôle est dévolu. C’est pour cette raison que les anarchistes doivent l’orienter et ne pas hésiter à prendre des postes responsables […]” [63]. Cette orientation dirigiste de la F.A. se confirme le 11 mars 1950 au congrès de la région parisienne : “Toute organisation para-anarchiste, non-affiliée statutairement à la F.A. devra, dans le cadre régional, être sous le contrôle direct du bureau de la région, son action influencée par les militants de la F.A.” [64].
Le soutien de la F.A. en faveur de la C.N.T. fut perçu de deux manières. Il est positif puisqu’il amena à la C.N.T. des adhérents de la F.A., et la C.N.T. pu bénéficier d’un outil de propagande à travers le Libertaire dans lequel elle multiplia les appels à quitter la C.G.T. pour venir la rejoindre. En 1947 et 1948, le Libertaire laisse en effet une large place à la C.N.T. La quatrième page traitant du syndicalisme est systématiquement consacrée à la C.N.T. avec des articles de militants de la C.N.T., des communiqués des U.L., des fédérations ou du Bureau Confédéral. La première page du Libertaire est parfois laissée à la C.N.T., notamment lors des grèves de novembre 1947. On peut également lire des appels tel que : “Adhérez à la Fédération Anarchiste ! Syndiquez-vous à la C.N.T. !” [65]. Même après la création de F.O., les articles restèrent favorables à la C.N.T. Ce soutien permit en revanche aux adversaires de la C.N.T. ou à ceux qui étaient réticents vis-à-vis d’elle, de l’identifier à la F.A. Ainsi, pourquoi quitter une C.G.T. entre les mains des communistes pour rejoindre une C.N.T. entre les mains des anarchistes ? Il était cependant faux d’affirmer que la C.N.T. était contrôlée par la F.A. Il est indéniable que certains responsables de la C.N.T étaient en même temps responsables à la F.A. (Joyeux, Jacquelin, Fontenis, Joulin,…). Parane affirmait au contraire que la C.N.T. et la F.A., c’était la même chose : “Il a fallu deux ans pour s’apercevoir qu’en bien des localités, les syndicats de la C.N.T. n’étaient en fait que des groupes anarchistes réunis dans un même local, animés par les mêmes copains, mais disposant d’un cachet supplémentaire”. [66]
Si identifier la C.N.T. à la F.A. est exagéré, les liens entre la C.N.T. et le mouvement anarchiste restent forts. Le paysage anarchiste de l’entre-deux-guerre se retrouve en effet à la C.N.T.
Ce qui divisa la C.N.T., ce fut la question de savoir si elle était une centrale syndicale anarchiste ou une centrale syndicaliste révolutionnaire. Autrement dit, la C.N.T. était-elle une organisation politique qui plaçait la fidélité aux principes anarchistes avant l’action syndicale ?
b) Divisions entre syndicalistes anarchistes et syndicalistes révolutionnaires
Le débat autour de la nature de la C.N.T. se manifeste essentiellement par rapport à l’article 7 des statuts. Cet article stipulait au départ que le syndicalisme était indépendant de tout parti politique, de toute secte philosophique ou religieuse. Les militants qui étaient adhérents à la F.A. refusèrent l’adoption de cet article. Henri Bouyé, lors du congrès constitutif, affirma que “si nous acceptons l’article 7 dans sa teneur actuelle, il est impossible à un camarade de la Fédération anarchiste d’être responsable de la confédération. Nous ne pouvons l’admettre.” Les responsables des provinces étant le plus souvent adhérents à la F.A., ils eurent la majorité et modifièrent cet article qui devint : “La confédération est indépendante de tout parti politique, sectes philosophiques ou religieuses ne se réclamant pas de la lutte des classes”, ce qui revenait à rompre l’indépendance de la confédération à l’égard de la F.A. Cette décision entraîna le départ d’un des fondateurs de la C.N.T., Julien Toublet. Dans une lettre adressée à la C.N.T. datée du 14 décembre, il écrit : “Ils (les délégués anarchistes) n’ont pas su résister à la tentation de faire de la C.N.T. naissante, une C.N.T. anarchiste”. Selon Toublet, l’article 7 a été rédigé de telle sorte que les responsables de la F.A. puissent concilier leur poste avec un poste responsable de la C.N.T. Cette décision ne peut que conduire la C.N.T. à l’isolement étant donné “la tradition syndicale dans ce pays, toute axée sur la notion de l’indépendance du syndicalisme”. Toublet décida alors de créer l’Union Fédéraliste du Syndicalisme Indépendant. Dans une seconde lettre, il écrit que “pas un minoritaire apolitique de la C.G.T. ne peut accepter le texte que vous avez adopté”. Ainsi, ce que Toublet affirme, c’est que la C.N.T. ne peut recruter que des adhérents déjà acquis aux idées anarcho-syndicalistes [67].
Mais au congrès de 1950, il est décidé de reformuler l’article 7 tel qu’il avait été présenté au congrès constitutif de décembre 1946. Cette modification de l’article peut s’expliquer par le départ de la C.N.T. de nombreux responsables de la F.A. à la suite du retrait du cartel, mais aussi de la génération qui était adhérente avant la guerre à la C.G.T.S.R., laissant alors la majorité à ceux qui se désignent comme syndicalistes révolutionnaires en opposition aux anarchistes syndicalistes. A ce congrès, il est aussi question de savoir s’il faut coller l’étiquette anarcho-syndicaliste à la C.N.T. Toublet affirme que le fait de coller l’étiquette anarcho-syndicaliste à la C.N.T. la viderait. Cette tendance syndicaliste révolutionnaire était plus modérée que celle des anarcho-syndicalistes ou “anarchistes syndicalistes”, puisqu’elle reconnaissait l’utilité de la représentativité de la C.N.T. dans les différents organismes. Pour ces adhérents catalogués comme “modérés” ou “réformistes”, le syndicat doit être révolutionnaire dans sa finalité, mais réformiste dans son action journalière. Ils étaient donc partisans de représenter la C.N.T. au sein des comités d’entreprises, des conseils des prud’hommes et des commissions paritaires. Mais seule la participation aux élections des délégués du personnel fut acceptée au congrès de 1950.
délégués du personnel fut acceptée au congrès de 1950.
A propos de la représentativité, Aimée Capelle indique que “En 46, nous avions reçu du Ministère du Travail des imprimés à remplir, sur l’activité de l’organisation pendant l’Occupation. Elle n’existait pas mais la C.G.T.S.R. existait. En somme, la C.N.T. était la continuation de la C.G.T.S.R. et elle avait la possibilité de demander la représentativité, au même titre qu’elle avait été accordée à la C.G.T. et à la C.F.T.C. […] Les imprimés n’ont pas été remplis”. On peut trouver naïf que certains aient cru que la représentativité puisse être accordée à la C.N.T., mais en l’occurrence la C.N.T. a tout simplement refusé de la demander.
Ainsi on peut observer deux tendances quant à la définition de la C.N.T. La première, anarcho-syndicaliste, qui a dirigé la C.N.T. entre 1946 et 1950, a certainement contribué à l’isolement de la C.N.T. par son attitude un peu puriste. La seconde en revanche, si elle est plus souple, va à l’encontre des principes anarcho-syndicalistes. Ce dilemme constitue le point faible de l’anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire organisés dans une centrale se réclamant de ces courants.
On constate qu’après cinq années d’existence, du fait des luttes internes et des prises de position controversées, la C.N.T. s’est considérablement affaiblie. Dans son article intitulé “vivant” [68], Parane nous explique les raisons de cette courte apogée qu’a connu la C.N.T. entre 1946 et 1950 : “Souvenirs fumeux de la révolution espagnole, regrets imprécis de la C.G.T.S.R., envie d’être entre copains, croyance que les sursauts manifestés chez les cheminots, les postiers, les métallos supposaient des troupes prêtes à se grouper sous notre bannière, voilà quelques uns des éléments qui ont contribué à cette flambée d’enthousiasme. […]. Nous avons fait trop de syndicalisme de meeting et trop de syndicalisme théorique. Et les occasions que l’actualité nous présentait ont échappé à notre propagande et à notre action”.
NOTES
[1] Notons toutefois ce témoignage de Paul Lapeyre sur René Doussot : “…Pendant toute la durée de l’occupation, DOUSSOT réunit chez lui, chaque mois, la Commission administrative du S.U.B. (Syndicat unique du Bâtiment) passé à la C.G.T.S.R. et du S.U.M. (Syndicat unique des Métaux) et tint à jour les procès-verbaux de ces réunions, pour prouver que la C.G.T.S.R. avait continué d’exister. On peut en sourire aujourd’hui ; n’empêche : si la police avait découvert ces cahiers, DOUSSOT aurait été au moins déporté….”, Les anarchistes dans la résistance, volume 2, C.I.R.A.
[2] Appel aux Syndicalistes Révolutionnaires, C.I.R.A. de Marseille.
[3] Les témoignages de Aimé Capelle sont extraits de l’ouvrage de CAROUX-DESTRAY Jacques. Un couple ouvrier traditionnel. La vieille garde autogestionnaire. Paris, Anthropos, 1974, pp. 189-212 (Aimé Capelle est présenté sous le nom d’Amédée Domat dans ce livre, mais un recoupement avec les archives de l’organisation permet de l’identifier).
[4] Statuts de la Fédération Syndicaliste. Archives de la C.N.T. de Toulouse.
[5] BIARD Roland. Histoire du mouvement anarchiste. 1945-1975. Editions Galilée, 1976, p. 92. Contrairement ce qu’affirme Biard, ce n’est pas cette prise de position des dirigeants cégétistes qui provoqua la scission.
[6] Nos Cahiers. Bulletin mensuel du Comité d’Etudes Techniques Economiques et Sociales. N°13, 1er octobre 1946. Il s’agit d’une revue publiée par des adhérents de la C.G.T. se réclamant du syndicalisme révolutionnaire.
[7] Après la création de F.O., ils formeront la tendance “Unité syndicale”.
[8] Ce titre fait référence à la création de la CGT-U en 1921. Lors de ce congrès, les exclus de la CGT ou les déçus (communistes, syndicalistes révolutionnaires de la tendance de Pierre Monatte, anarcho-syndicalistes, même si ce qualificatif n’est pas encore utilisé, de la tendance de Pierre Besnard et anarchistes) se réunissent pour fonder une CGT unitaire en opposition à la CGT devenue trop réformiste. Mais la position des syndicalistes révolutionnaires fera de cette nouvelle CGT un outil aux mains du tout nouveau PCF (encore appelée SFIC). Ainsi, tout comme en 1921, ce congrès de 1946 fait de la CGT un instrument du PCF. Sur cette scission de 1921, cf. l’ouvrage assez vieilli mais bien complet de Maurice LABBI. La grande division des travailleurs. Première scission de la CGT : 1914-1921. Les Editions ouvrières, 1964.
[9] On peut se demander, étant donné la nature de cet appel à la conférence qui décide avant même son déroulement la constitution de la C.N.T. et son adhésion à l’A.I.T., si le regroupement des anarcho-syndicalistes au sein de la F.S.F. et des C.D.S. n’avait pas comme objectif de préparer la constitution d’une centrale anarcho-syndicaliste, comme ils l’avaient déjà fait en 1921 avec le pacte secret de Pierre Besnard. Les anarcho-syndicalistes devaient bien avoir conscience de ne jamais pouvoir peser sur les orientations de la C.G.T. Cette hypothèse est d’autant plus probable que lors des assises du mouvement libertaire tenues les 6 et 7 octobre 1945, la F.S.F. avait déclaré : “Il est urgent de créer la force du syndicalisme véritable qui s’opposera à celle de la C.G.T. communiste […]”, façon indirecte d’annoncer la création prochaine de la C.N.T. Compte-rendu des “Assises du mouvement libertaire et du congrès de la F.A. (6 et 7 octobre et 2 décembre 1945)”, cité par D’OVIDIO Pierre. Les anarchistes en France de 1945 à la veille de mai-juin 1968. Mémoire de maîtrise, sous la direction de Jean Maitron et Jacques Droz. Paris I, 1974, p.109.
[10] En effet, la C.G.T.S.R. n’a pas connu un grand succès. Le nombre des adhérents étant très faible, certains anarchistes l’appelaient la “C.G.T.-Sans Rien”.
[11] Ordre du jour qui reste assez vague, certainement pour attirer le plus de monde possible parmi les syndicalistes déçus par la C.G.T. L’orientation ouvertement anarcho-syndicaliste aurait pu provoquer une certaine réticence chez les syndicalistes.
[12] Pour Besnard, la lutte des classes ne devait pas se restreindre aux lieux de travail et devait prendre en compte les problèmes du quotidien, l’homme n’étant pas qu’un producteur mais aussi un consommateur.
[13] Il se situera à partir de 1947 au 39, rue de la Tour d’Auvergne dans le 9ème. Ce local est toujours utilisé par les compagnons de la “C.N.T. 2° UR”, cf plus loin.
[14] “Rapport sur l’activité de la Commission administrative et du Bureau confédéral du 6 mai 1946 au 13 octobre 1946” rédigé par Eugène Juhel, alors secrétaire à la propagande.
[15] Il s’agit du total des souscriptions parues dans L’Action Syndicaliste entre mai et novembre 1946.
[16] Circulaire confédérale n°5, s.d.
[17] Par copie conforme, nous entendons mot pour mot, excepté quelques détails qui ont été supprimés ou ajouté du fait du contexte historique. Les statuts des deux organisations sont également très proches. Il n’y a aucune différence dans le fond.
[18] Il est intéressant de voir l’importance de la charte d’Amiens pour les organisations syndicales. Se référer à celle-ci sert à se donner une légitimité et à se présenter comme la vraie incarnation du syndicalisme. La C.G.T. de 1906 devient alors le référant et l’idéal type du syndicalisme.
[19] Nous reviendrons sur ce thème de l’unité qui divisera la C.N.T.
[20] Il s’agit des syndicats des métaux, transports et manutention, textile, bois-ameublement, cuirs et peaux, employés, métiers d’art, S.U.B., fonctionnaires et santé publique, service santé, H.C.R.C. et cheminots (ce syndicat compte 6 sections, mais après discussion ces 6 sections comptent comme un syndicat).
[21] Après la victoire des franquistes en 1939, les Espagnols du sud ne pouvant plus rejoindre la France métropolitaine se sont exilés au Maghreb français.
[22] L’organe de la F.T.R. prendra successivement le titre de Rail enchaîné, puis à partir de juin 1947 Le Cri du cheminot et enfin après son congrès fédéral de septembre 1948 Rail-C.N.T.
[23] BEAULATON Raymond. Contribution à l’histoire de la C.N.T. (1945-1950). s.d., 11 p.
[24] DOLLEANS Edouard et DEHOVE Gérard. Histoire du travail en France. Mouvement ouvrier et législation sociale. T.2 : de 1919 à nos jours. Editions Domat Montchrestien, 1955.
[25] Contre-rapport sur le rapport moral de l’U.L. de Bordeaux pour le congrès confédéral de septembre 1948.
[26] HAMELET Michel P. “où va le syndicalisme français ?”, Revue de Paris, janvier 1949.
[27] Le 31 octobre 1947, sur 1293 cartes vendues, on compte 479 pour le S.U.B. Ainsi, en un an, le nombre d’adhésion de ce syndicat aurait été multiplié par 9,45. Probablement un autre « feu de paille ».
[28] FROLAN Xavier. Notre place dans le mouvement ouvrier français. Ed. C.D.E.S. (Centre de Documentation et d’Etudes Sociales), s.d., 26 p.
[29] BIARD Roland relève dans cette même usine une grève “à direction C.N.T.” en décembre 1946.
[30] FALLACHON P. “grèves de la Régie Renault en 1947”, Mouvement social, n°81, 1972.
[31] Témoignage d’un cheminot fait le 9 juin, rapporté dans le numéro de juillet 1947 de la revue Esprit.
[32] AURIOL Vincent. Journal du septennat. 1947-1954. T.1. : 1947. Armand Colin, 1970.
[33] COURTY-VALENTIN Marie-Renée. Les grèves de 1947 en France. Thèse de 3ème cycle, sous la direction d’Antoine Prost, I.E.P. de Paris, 1981, p. 244.
[34] Le Combat syndicaliste, N°3, juin 1947.
[35] Le Combat syndicaliste, n°9, 13 janvier 1949.
[36] Le Combat syndicaliste, n°21, janvier 1950.
[37] Le Combat syndicaliste, n°21, janvier 1950.
[38] Le Combat syndicaliste, n°14, 1er juin 1949.
[39] Compte-rendu du congrès de 1950.
[40] Ces comités mixtes à la production ou comités de gestion étaient constitués par les travailleurs dans certaines usines dont le patron avait collaboré avec l’Allemagne. ANDRIEU C., LE VAN L., PROST A. (sous la direction de). Les nationalisations à la Libération. De l’utopie au compromis. F.N.S.P., 1987, 392 p.
[41] Le Combat syndicaliste, n°14, 1er juin 1949.
[42] Voir à ce sujet le témoignage de PEYRENET Marcel. Nous prendrons les usines. Les usines Berliet à Lyon. Garance, 1980.
[43] Des militants de la C.N.T. travaillaient dans ces usines Berliet.
[44] On peut également envisager tout simplement, qu’étant absente des autres usines où ont été constitués des comités de gestion, elle préfère ne pas se prononcer sur ces expériences.
[45] Le Combat syndicaliste, n°9, 13 janvier 1949.
[46] Contre-rapport au rapport moral présenté par l’U.L. de Bordeaux à l’occasion du congrès confédéral de septembre 1948.
[47] BEAULATON Raymond. Contribution à l’histoire de la C.N.T. 1945-1950. s.d., p. 3.
[48] Contre-rapport de l’U.L. de Bordeaux.
[49] Circulaire confédérale n°19, non datée.
[50] On retrouve lors du congrès constitutif de F.O. tenu les 12 et 13 avril 1948, plusieurs déclarations appelant à la constitution d’une centrale qui permettrait un large regroupement syndical. Certaines déclarations montrent une certaine sympathie pour la C.N.T. ; certains proposèrent même l’adhésion à l’A.I.T. et non à la F.S.M.
[51] BEAULATON Raymond. op. ci t. p. 4.
[52] Bulletin Intérieur de novembre 1948.
[53] Ibid.
[54] Révolution prolétarienne, n°327, mars 1949.
[55] Circulaire confédérale n°11, juin 1949.
[56] Lettre de Arthur Guiller, adhérent de la 4ème U.R., envoyée au bulletin intérieur
[57] Bulletin intérieur, n°12, novembre-décembre 1949.
[58] Beaulaton et Robert créent par la suite l’A.S.C.A. (Alliance Syndicale des Cheminots Anarchistes) dont l’organe est le Rail enchaîné (n°1, avril 1953). Ils prévirent pour 1954, la création d’une “Confédération syndicale des travailleurs anarchistes avec l’Alliance anarchiste des P.T.T. et l’Alliance syndicale anarchiste de la R.A.T.P.”. Cette confédération ne naîtra jamais, ou peut-être qu’il s’agit de l’Alliance Ouvrière Anarchiste (A.O.A.) créée en 1956.
[59] Les anarcho-syndicalistes français ont d’une certaine manière repris le modèle espagnol. La C.N.T. espagnole était en effet ouvertement anarchiste puisqu’elle s’était dotée d’une organisation politique anarchiste, la F.A.I. (Fédération Anarchiste Ibérique). Or le succès du modèle espagnol s’explique par des raisons historiques qui ne sont pas les mêmes en France. En Espagne, l’anarchisme dominait le mouvement ouvrier, alors qu’en France, il n’était qu’une composante minoritaire de celui-ci.
[60] En prenant un échantillon de militants qui ont participé à la création de la C.N.T. (par exemple en se référant au Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier), on voit clairement que la C.N.T. a principalement été crée par des anarchistes de l’entre-deux guerres.
[61] Le Lien, bulletin intérieur de la F.A., N°3, janvier-février-mars 1946.
[62] Maurice Joyeux quitte la C.N.T. pour rejoindre la C.G.T.F.O. à laquelle il adhère jusqu’à sa retraite. Son départ de la C.N.T. pour F.O. est cependant assez contradictoire puisqu’il s’opposait à une unité entre la C.N.T. et la F.O. Il est également étonnant que dans ses ouvrages autobiographiques, Maurice Joyeux ne fasse jamais allusion à son passage à la C.N.T. qu’il a pourtant contribué à fonder. D’après Raymond Beaulaton, certains militants avaient la double appartenance C.N.T. et F.O.
[63] Citation extraite de BIARD Roland. Histoire du mouvement anarchiste. 1945-1975. Editions Galilée, 1976, p. 97.
[64] Ibid. Notons que le courant de Fontenis ne faisant pas l’unanimité fut à l’origine d’une scission à la F.A. Fontenis créa alors la Fédération Communiste Libertaire (F.C.L.).
[65] Première page du Libertaire du 12 juillet 1947.
[66] PARANE S. “vivant”, Etudes anarchistes, n°6, mai 1950.
[67] Toublet revient néanmoins à la C.N.T. en 1950 et est nommé responsable du C.S., après l’exclusion de Fernand Robert. Il quittera par la suite une nouvelle fois la C.N.T.
[68] PARANE S. “vivant”, Etudes anarchistes, n°6, mai 1950.